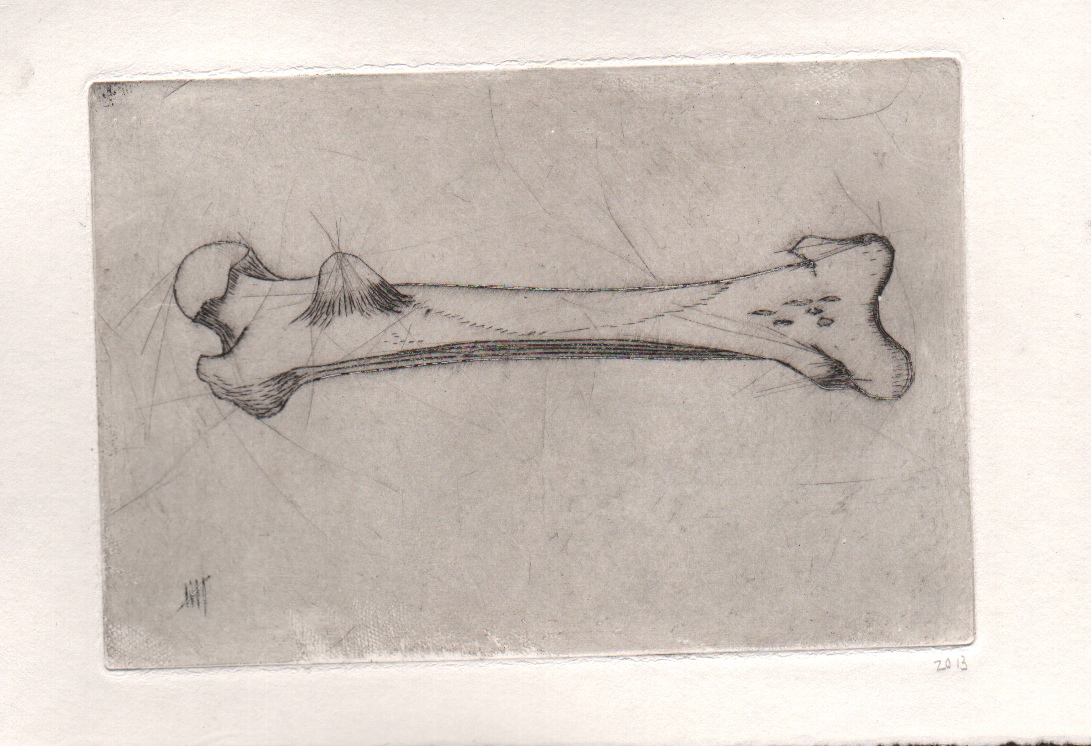Autore
Indice
- La Gestalt urbaine
- Un cas concret: le Russell Street Corridor
- La cybernétique et l’urbanisme
- Une smart city avant l’heure
S&F_n. 13_2015
Abstract
This paper will address the question of aesthetic road design in relation with the psychology of the perception, in the United States during the second half of the twentieth century. Taking the work of the artist and theoretician Gyorgy Kepes (1906-2001) as a starting point, I propose to discuss the evolution of urbanism, from a gestalt informed perspective to a cybernetic one, which anticipated the emergence of the concept of smart city.
- La Gestalt urbaine
Le 28 octobre 1954, lors d’un colloque organisé au MIT sur la question de la perception de la forme de la ville, on assista à l’échange suivant entre le compositeur John Cage, l’urbaniste Kevin Lynch et l’artiste György Kepes à propos de l’environnement sonore urbain:
Cage: Je crois qu’il vaudrait mieux abandonner l’idée du contrôle et plutôt apprécier l’absence de contrôle.
Lynch: Vous croyez donc qu’une personne devrait s’entraîner à jouir de ce qui est là, plutôt que d’essayer de contrôler l’environnement.
Cage: Quelle serait l’intention derrière un ordre imposé?
Kepes: Comme l’environnement sonore moyen est une situation aléatoire, de petits îlots d’ordre à l’intérieur de ce hasard pourraient aider à catalyser un modèle général ordonné. […]
Cage: Ne pourrions-nous pas à la place éveiller le public aux possibilités offertes par une situation aléatoire?[1]
Dans cet échange portant sur la notion d’aléatoire s’opposaient deux visions de ce que devait être l’environnement urbain. Celle de John Cage se base sur une définition positive du désordre, où les situations aléatoires et incontrôlées qu’il génère offrent la possibilité d’expériences esthétiques inédites. Celle de György Kepes, au contraire, défend l’idée d’un ordre à imposer ponctuellement dans le tissu urbain, tant au niveau de la perception visuelle que de la perception auditive. Pour Cage, il fallait trouver un moyen de sensibiliser le public aux qualités du désordre, tandis que ce qui importait à Kepes, c’était de donner au public une image cohérente de la ville. L’idée d’imposer un ordre à la ville n’était certes pas neuve, mais ce qui faisait la particularité de la démarche de Kepes, c’est qu’il ne s’agissait pas de défendre une politique de tabula rasa et du contrôle total, mais plutôt d’intervenir localement de manière à faire émerger un ordre, non seulement dans le tissu urbain, mais, plus encore, dans la perception qu’en aurait son occupant. Il ne s’agissait pas d’imposer un ordre rigide, mais bien de considérer la ville comme un système ouvert, dont il fallait révéler les processus, les infrastructures, et améliorer le fonctionnement. Tirant parti, dans un premier temps, de la psychologie de la perception développée par l’école de Berlin – la psychologie de la forme ou théorie de la Gestalt –, puis, dans un second temps, de la cybernétique, Kepes fit durant sa carrière un certain nombre de propositions qui anticipaient le phénomène que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de smart cities ou «villes intelligentes».
Peintre, photographe, éditeur et enseignant né en Hongrie en 1906, Kepes fut formé aux Beaux-Arts de Budapest avant de rejoindre László Moholy-Nagy à Berlin. Au cours des années 1930, Kepes suivit Moholy-Nagy à Londres, puis à Chicago, où il contribua à la fondation du Nouveau Bauhaus en 1937. Bénéficiant du réseau de connaissances de Moholy-Nagy, et partageant avec ce dernier une pratique artistique ne se cantonnant pas à un médium particulier, et un intérêt poussé pour les sciences, Kepes a très vite orienté sa carrière autour de la notion d’ordre, ainsi que le rappelait Otto Piene dans son hommage rédigé lors du décès de l’artiste en 2001[2]. L’idée d’ordre chez Kepes trouve plusieurs sources. Premièrement, elle tient à la conception organiciste et collectiviste du monde défendue par les avant-gardes hongroises du début du siècle[3]. Cette idée d’un ordre social et biologique fut alimentée par la fréquentation de Kepes des psychologues de la Gestalt. Cette branche de la psychologie considère en effet le champ perceptif comme étant organisé en des totalités cohérentes – les Gestalten – en fonction de règles structurantes: différence entre fond en forme, principe de continuité et de fermeture[4]. Pour Kepes, comme pour le psychologue Rudolf Arnheim, qui participa au développement de la Gestalt aux États-Unis et aux séminaires de Kepes, un environnement peu favorable à la formation perceptive de Gestalten pouvait avoir un impact sur la santé mentale de l’homme. L’environnement visé était l’environnement urbain. Le premier livre de Kepes, Language of Vision (1944), commençait ainsi par la phrase: «Aujourd’hui, nous faisons l’expérience du chaos»[5], tandis qu’Arnheim formulait sa critique en ces termes:
Notre environnement visuel est dominé par des infrastructures humaines collées les unes aux autres par l’entreprise désordonnée d’individus. Le chaos qui en résulte aura vraisemblablement des effets pervers, parce que le seul moyen d’y résister serait d’abolir notre sens de la structure et de lui substituer une vision fragmentée. Ce qui serait un mal déjà suffisant si ce handicap de la vision était limité à notre réponse aux apparences du monde extérieur. […] L’apparence perçue est en effet à la base de tous les phénomènes cognitifs de compréhension[6].
C’est autour de la question de définir ce qu’était un environnement urbain sain, et de comprendre comment celui-ci était perçu, que Kepes se lança avec l’urbaniste Kevin Lynch dans une étude sur la perception de la ville de 1954 à 1959 au MIT. Lors de cette recherche, qui donna lieu au livre de Kevin Lynch The Image of the City (1961)[7], Kepes se lança dans une vaste enquête phénoménologique, informée par la Gestalt, sur la manière dont un piéton ou un conducteur pouvaient percevoir la ville et s’y orienter. Les auteurs devaient isoler six facteurs structurant le paysage urbain: chemins, limites, districts, nœuds et points de repère – landmarks –, ainsi que leurs interrelatio[8].
La méthodologie utilisée se rapprochait formellement du story-board cinématographique: il s’agissait de décrire sur le vif, à l’aide de croquis annotés, des séquences entières de la ville, en l’occurrence Boston, afin de dégager les facteurs d’ordre et de désordre dans la perception de la ville[9]. Il s’agissait, comme l’a formulé l’historien Clément Orillard, de rationaliser le discours esthétique dans le but de définir un urbanisme cognitif qui saisirait l’image mentale de la ville[10].
- Un cas concret: le Russell Street Corridor
Les connaissances engrangées lors de l’étude sur la perception de la forme de la ville devaient donner lieu, pour Kepes, à des applications concrètes visant à assainir l’environnement urbain. Déjà en 1944, lors de la publication de Language of Vision, cette question était abordée à travers l’affiche publicitaire. Trente ans plus tard, en 1973, elle occupait encore l’artiste, qui trouva à Baltimore l’occasion de mettre en pratique son idée de l’ordre. Dans ce cas précis, Kepes proposa de redessiner totalement les abords de l’autoroute reliant la ville de Baltimore à son aéroport. Prenant le point de vue de l’automobiliste, Kepes constatait que le parcours de l’aéroport au centre-ville n’offrait pas un spectacle structuré, mais au contraire, une autoroute banale au centre d’un désordre de panneaux publicitaires et de signalisation, sans que l’arrivée à l’aéroport ou au centre-ville ne soit clairement signifiée à l’automobiliste. En effet, l’autoroute parcourait – et parcourt toujours aujourd’hui, le projet de Kepes n’ayant pas été réalisé – le paysage mal défini du sprawl urbain américain, avant de se fondre imperceptiblement dans la ville. Pour Kepes, il manquait un symbole clair, un point de repère monumental, marquant l’arrivée à Baltimore ou à l’aéroport[11]. Kepes identifiait encore un manque de connexions entre les différents éléments de la route. Il notait l’absence d’un principe général régulant les aménagements du bord de route, ce qui empêchait le conducteur d’éprouver un sens de la continuité dans son expérience du parcours[12].
Dans une perspective holistique, une séquence routière idéale devait former une Gestalt dans le regard du conducteur. C’est ce qui manquait dans le cas de Baltimore, puisque l’autoroute n’avait pas vraiment de fin, elle cessait simplement d’exister après avoir imposé à son usager des changements rapides et incohérents de vitesse, d’échelle et de décor.
Pour remédier à ces maux, Kepes suggéra de ponctuer le trajet en soulignant ses éléments dominants: l’aéroport, une usine au centre du parcours, et l’entrée dans la ville. Pour l’arrivée et la sortie de l’aéroport, Kepes souhaitait scénariser la route à l’aide de formes disposées à intervalles régulières et distillant aux conducteurs des informations sur les vols, les parkings, les horaires et la météo. Pour l’entrée et la sortie de la ville, il proposait une porte clairement définie sous la forme de deux fontaines géantes encadrant la route, dont les formes devaient contraster avec l’arrière-plan, équipées de lasers projetant leurs rayons dans le ciel. La combinaison d’eau et de lumière devait être un complément à la décélération du conducteur à son entrée en ville. Des panneaux touristiques, avec des plans de la ville, devaient encore aider le conducteur à s’orienter tout en le «connectant» avec la vie de la cité, comme dans la proposition de projeter les dernières dépêches sur des supports visuels. La signalisation – ou communication – devait également être contrôlée et organisée. Il s’agissait de supprimer les redondances, et de grouper autant que possible les éléments signifiants en des unités lisibles, de façon à retenir, et non monopoliser, l’attention du visiteur, tout en n’handicapant pas sa concentration au volant[13].
- La cybernétique et l’urbanisme
Pour Kepes, l’environnement de la route était principalement un espace d’information, puisqu’il s’agissait de bien orienter le conducteur. En cela, Kepes se réclamait ici, au-delà de la théorie de la Gestalt, de la cybernétique. Cette discipline, à l’origine des sciences de l’information, avait été baptisée ainsi par le physicien Norbert Wiener à partir du mot grec signifiant «art de bien gouverner». La cybernétique permettait d’exprimer une machine ou un organisme comme un système régulé s’appuyant sur la bonne circulation de l’information et réagissant avec son environnement par le biais de processus de rétroaction – ou feedback[14]. Kepes connaissait bien Norbert Wiener, qui travaillait sur le même campus que lui, celui du MIT, et à qui il commanda un article pour son livre The New Landscape in Art and Science, et c’est en des termes cybernétiques qu’il parlait en 1972 de l’environnement comme d’un système autorégulé[15]. On peut alors considérer la route de Baltimore comme une sorte de lieu cybernétique dirigeant le conducteur à bord de son véhicule sur des voies de communication prédéfinies par le gouvernement et déterminant la morphologie de la ville. Il s’agissait de faire circuler au mieux le voyageur en l’orientant correctement par la suppression du bruit dans la signalisation, et par la stimulation de son attention en créant un environnement varié et rythmé. Une séquence cohérente devait donner au conducteur une image claire et saine de la ville, dont les effets devaient se répercuter sur sa santé mentale.
L’idée d’associer l’urbanisme à la circulation d’information trouve un second exemple concret dans un autre projet non réalisé de Kepes, contemporain de celui de Baltimore, le projet de réaménagement de Times Square à New York. Dans ce cas, Kepes pouvait s’appuyer sur l’art cybernétique, en particulier sur les travaux de l’artiste hongrois établi à Paris Nicolas Schöffer. Dans les années cinquante, ce dernier avait en effet proposé une tour cybernétique de trois cents mètres de haut pour le quartier de la Défense à Paris. La particularité de cette tour, qui ne fut pas réalisée, était la suivante: grâce à une série de capteurs disséminés dans la ville et par le biais d’un système de communication lumineuse, elle devait transmettre en temps réel des informations concernant, par exemple, le cours de la bourse, la météo ou les embouteillages. Un tel monument devait donc participer à l’autorégulation de la ville, puisque le comportement des habitants devait être traduit en signaux visibles par tous, ce qui par rétroaction pouvait modifier ce même comportement. C’est cette même idée que Kepes entendait installer à Times Square, sous la forme de fontaines d’informations. Celles-ci devaient trouver leur place dans le système de signalisation et d’éclairage que Kepes souhaitait mettre en place pour restaurer ce quartier, et qui devait tirer parti des mouvements lumineux aléatoires de la ville. Il offrait ainsi de jouer avec les tonalités en éclairant tout le quartier d’une seule couleur changeant à intervalles réguliers et donnant l’illusion du mouvement, ce qui permettait par la même occasion de donner une identité distincte aux différentes zones du quartier[16]. L’environnement prenait dans ce projet une nouvelle dimension phénoménologique et sociologique, puisqu’il intégrait le visiteur, le passant et le touriste, qu’il transformait en participants à travers diverses interfaces électroniques. Cette participation devait trouver son climax dans les Light Festivals que Kepes proposait d’organiser à Times Square. L’orchestration événementielle de l’espace public, qui devait devenir un des fers de lance du marketing urbain quelques années plus tard[17], était cependant utilisée ici par Kepes dans un but civique et non commercial.
- Une smart city avant l’heure
Ces deux exemples, celui du Russell Street Corridor de Baltimore et celui de Times Square à New York, préfigurent le phénomène que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Smart City, ou ville intelligente. Celle-ci repose, selon l’historien de l’architecture Antoine Picon, sur un usage intensif des technologies de l’information et de la communication, et son principal objectif est une meilleure efficacité environnementale. Picon ajoute encore que les mécanismes d’apprentissage et de raisonnement deviennent internes à la ville elle-même[18]. Si la technologie disponible à l’époque de Kepes ne permettait pas d’envisager réellement une ville pensante, il n’en demeure pas moins que celle-ci était considérée par l’auteur comme un système autorégulé, capable, grâce aux capteurs et aux fontaines d’information, de contrôler certains de ses paramètres. Cet intérêt de Kepes pour la ville intelligente est à situer dans un contexte architectural où de nombreuses propositions allaient dans ce sens, à travers les travaux d’Archigram ou du collectif Pulsa. Ce dernier groupe, qui fut invité par Kepes à contribuer au livre Arts of the Environment, publié en 1972, comparait d’ailleurs la ville à un circuit imprimé électronique, faisant de la transmission d’informations un élément déterminant de la morphologie urbaine[19].
L’intérêt de Kepes pour la cybernétique, qui se traduit dans ses textes et projets par un vocabulaire emprunté à la biologie et à la théorie des systèmes, illustre un tournant épistémologique dans la façon de concevoir la ville. Dans la première partie de cet article, nous avons vu que le projet The Perceptual Form of the City, informé par la Gestalt, avait un caractère de diagnostique: il fallait comprendre comment la ville était perçue et dans quelle mesure on pouvait améliorer son image. En intégrant les technologies de l’information, la ville n’est plus seulement une entité perçue, mais devient elle-même capable de perception. L’homme pouvait ainsi être intégré à l’environnement «ville» en tant que partie essentielle par le biais de capteurs, que l’on peut qualifier en ce sens de prothèses sensorielles (rappelons que pour Norbert Wiener, l’une des applications souhaitées de la cybernétique était précisément la création de prothèses sensorielles)[20]. De plus, pour Kepes, le déploiement dans la ville d’organes perceptifs et informatifs devait contribuer à rendre la technologie familière à son usager: il s’agissait de combattre ce que Günther Anders appelait la «honte prométhéenne» suscitée par l’envahissement de technologies dont le fonctionnement reste incompréhensible à l’homme, du fait de leur trop grande complexité[21]. En faisant de l’habitant un participant actif de la technologie, Kepes entendait combattre ce sentiment d’aliénation, ce qui devait passer, à New York, par l’organisation de festivals technologiques autour de la lumière. La smart city de Kepes répondait donc à un triple objectif par le biais d’interventions ponctuelles: favoriser l’orientation de son usager en clarifiant son paysage, le transformer en acteur du «système ville», et enfin, contribuer à sa santé mentale en lui offrant un environnement urbain sain et compréhensible. En cela, les projets de Kepes, s’ils étaient encore tributaires des idéaux des avant-gardes du début du siècle, anticipaient bien les smart cities d’aujourd’hui, même si le caractère prophylactique de ces projets semble s’être depuis déplacé du domaine de la santé mentale vers celui de l’écologie, à laquelle Kepes était d’ailleurs profondément sensible.
[1] Interview with John Cage, James T. Farrell and Andreas Feininger by Kepes for the Urban Form Seminar, 18 octobre 1954, Stanford, M1796 Kepes, boîte 9, dossier 1.
[2] O. Piene, In memoriam: György Kepes, 1906-2002, in «Leonardo», XXXVI, 1, 2003, pp. 3-4
[3] O. Botar, Defining Biocentrism, in O. Botar, I. Wünsche (éds.), Biocentrism and Modernism, Ashgate Publishing Limited, Farnham 2011, pp. 15-45; et M. Wucher, Rereading Bioromanticism, ibid., pp. 47-60.
[4] M. Wertheimer, Laws of organization in perceptual forms (1923), in W. Ellis (éd.), A source book of Gestalt psychology, The Gestalt Journal Press, Gouldsboro 1997, pp. 71-88.
[5] G. Kepes, Language of vision. Painting, Photography, advertising-Design (1944), Paul Theobald, Chicago 1964, p. 12.
[6] R. Arnheim, Art and Humanism, in «Art Education», XXIV, 7, 1971, pp. 5-9.
[7] K. Lynch, The Image of the City, The MIT Press, Cambridge 1961.
[8] Ibid., pp. 46-90.
[9] J. Beinart, Report on the visual experience in a street in Boston – November IIth 1955, 2 novembre 1955, non paginé, Stanford University, M1796 Kepes, boîte 83, dossier 2.
[10] C. Orillard, Urbanisme et cognition. Deux tentatives américaines dans les années 1950 et 1960, in «Labyrinth », XX, 1, 2005, pp. 77-92.
[11] G. Kepes, Proposals for the Russel Street Corridor, non daté, Stanford University, M1796 Kepes, boîte 38, dossier 1.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Voir N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948), The MIT Press, Cambridge 1965.
[15] G. Kepes, The artist’s role in environmental self-regulation, in G. Kepes, (éd.), Arts of the Environment, George Braziller, New York 1972, pp. 167-197.
[16] G. Kepes, Times Square Project, non daté, Stanford University, M1796 Kepes, boîte 30, dossier 28.
[17] A. Klingmann, Brandscapes. Architecture in the Experience Economy, The MIT Press, Cambridge 2007.
[18] A. Picon, Smart Cities. Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur, Éditions B2, Paris 2013, pp. 7-26.
[19] Pulsa, The City as an Artwork, in G. Kepes (éd.), Arts of the Environment, cit., pp. 208-221
[20] N. Wiener, op. cit., p. 18
[21] G. Anders, Sur la honte prométhéenne, in Id., L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), Ivrea, Paris 2002, pp. 37-115.